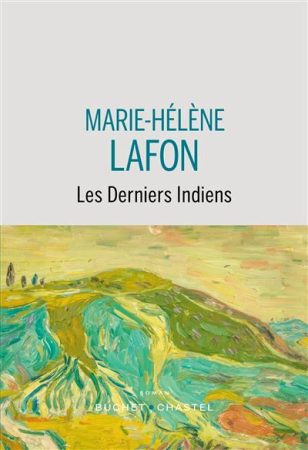Agrégée de grammaire, auteure d’une thèse de doctorat sur Henri Pourrat, écrivaine récompensée par le prix Goncourt de la nouvelle en 2016 et le prix Renaudot en 2020, Marie-Hélène Lafon est née à Saint-Saturnin. La rivière Santoire irrigue toute son oeuvre.
Les Derniers Indiens, éd. Buchet Chastel, 2008
Cet extrait est publié avec l’aimable autorisation des Editions Buchet Chastel « © Libella, Paris, 2008
Marie voyait la rivière l’été quand on faisait les foins et qu’elle allait râteler au pré le long de l’eau tous les après-midi. Jusqu’à plus de soixante ans, la mère, qui était encore alerte, venait avec elle. Ensuite elles avaient arrêté, les deux. Les femmes n’allaient plus au pré, on fanait sans râteler et on ne fauchait plus les coins inaccessibles aux machines. On les laissait. Les vaches les nettoieraient quand elles mangeraient le regain.
[…] Elle avait aimé râteler le foin sec avec la mère, jadis, elles ne parlaient pas, le foin sentait bon, et la Santoire menait sa coulée fraîche sous les frênes. On savait qu’elle était là, miroitante, son dos gris de cailloux ronds étiré dans la lumière. Elle la voyait aussi à l’automne quand elle allait encore garder les vaches avec le chien. Elle l’avait fait longtemps, même après l’entrée en usage des clôtures électriques. La rivière était basse, ses eaux rares et vives bruissaient et sentaient le cru. Elle n’aurait parlé de ça à personne, mais, plus tard, quand la mère avait dit qu’elle n’irait plus garder, que même les enfants ne le faisaient plus dans les autres maisons, que ça ne servait à rien, qu’il fallait vivre avec son siècle, elle avait regretté les larges yeux mouillés des vaches lentes et l’odeur de la Santoire. Elle l’entendait, on entendait toujours la rivière, de la maison, surtout les soirs, ou la nuit quand on fermait les volets de la cuisine l’hiver à six heures. En avril, les eaux montaient, gonflées des neiges qui commençaient à fondre dans les montagnes proches. Certaines années elles débordaient. On allait au tournant du haut pour voir. La mère s’inquiétait, elle disait que ça n’était pas bon pour le pré, pour les clôtures. Ça ne durait pas longtemps, et Marie, quand elle ramassait des pissenlits pour la salade, suivait le bourrelet capricieux de branches brisées, de feuillages et de terre mêlés d’autres choses inconnues d’elle que la rivière, se retirant, avait abandonné sur l’herbe jaune du pré. Elle lisait parfois dans le bulletin paroissial des articles sur la pollution de la Santoire. Le journal n’en parlait pas, mais Jean disait que c’était certainement vrai, les pêcheurs se plaignaient de la disparition des truites et on ne voyait plus d’écrevisses. Marie n’aimait pas penser à ces articles, elle préférait les oublier.
Album, éd. Buchet Chastel, 2012
Cet extrait est publié avec l’aimable autorisation des Editions Buchet Chastel « © Libella, Paris, 2012
Rivières
L’Auvergne est le château d’eau de la France. Disait le maître d’école. Créature des rivières bruissantes, le maître était homme des eaux, planté en cuissard vert au milieu du monde, précis et silencieux, lent et vif, ardent à attendre, pêcheur de toute éternité, au plus caché du bouquet de rivières secrètes qui ruissellent en étoile du vieux puy Mary.
Ces rivières savent la géographie et l’histoire, elles ont travaillé, creusé, creusé les vallées, inlassables, infimes et formidables, parfois disparues, réduites à rien, ruisselets dérisoires, et, plus loin, plus tard, glorieuses, retrouvées, gonflées de promesses.
Ma rivière d’enfance a nom Santoire. Elle borna le monde, c’est définitif, elle fut l’été, la plage d’ardoise, et l’immobile après-midi d’août, le temps arrêté dans le babil lumineux de son lit de cailloux. Elle fut de chaque hiver, et des printemps brefs, haute, pressée d’en finir, se hâtant, tournoyant à bout de gris, cinglant les branches nues et penchées. Horizontale, insolente et enfuie.
Car les rivières s’en vont. C’est fatal. Elles ont porté double guipure d’arbres vivaces, elles ont serpenté en anneaux paresseux, elles ont tranché dans le gras des terres brunes, elles ont bercé les nuits closes de leur respiration ténue ou mugissante, elles ont été là, elles ne cessent pas, elles s’en vont et continuent dans nos veines.
Un très grand merci à Marie-Hélène Lafon et aux éditions Buchet-Chastel pour leur aimable autorisation !